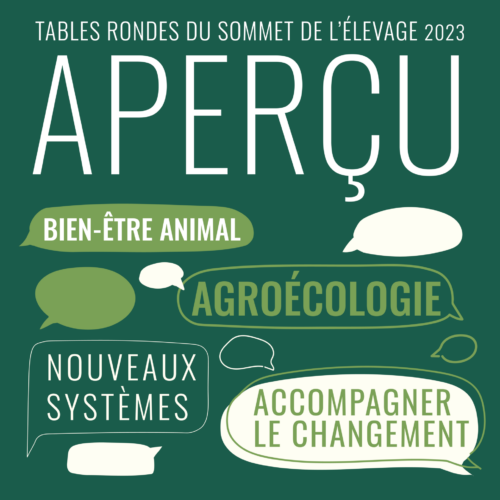La Chaire était présente au Sommet de l’élevage 2025 ! Nous avons eu le plaisir d’animer une table ronde sur les rapports entre éleveurs et citoyens avec autour de la table cinq intervenants venus échanger :
- Philippe Collin, agriculteur en polyculture-élevage en Haute-Marne
- Julia Dissard, co-référente d’une ferme Terre de Liens
- Arnaud Leclercq, agriculteur en polyculture-élevage dans l’Aisne
- Luc Mounier, enseignant-chercheur en bien-être animal et responsable de la Chaire
- Claire Rogel-Gaillard, directrice scientifique adjointe Agriculture en charge des systèmes d’élevage durables à l’INRAE
Retrouvez ici un compte rendu de cette table ronde !

à retenir
- Le fossé entre citoyens et éleveurs relèverait surtout d'un manque de compréhension que d'une déconnexion des citoyens.
- L’éducation apparaît comme un levier essentiel pour retisser le lien entre citoyens et éleveurs, que ce soit à l’école ou à travers l’alimentation.
- La transition de l’élevage vers des pratiques plus durables demande du temps, mais aussi l'investissement de tous les acteurs : éleveurs, chercheurs, consommateurs, élus, industriels...
La Chaire était présente au Sommet de l’élevage 2025 ! Nous avons eu le plaisir d’animer une table-ronde sur les rapports entre éleveurs et citoyens avec autour de la table cinq intervenants venus échanger :
- Philippe Collin, agriculteur en polyculture-élevage en Haute-Marne
- Julia Dissard, co-référente d’une ferme Terre de Liens
- Arnaud Leclercq, agriculteur en polyculture-élevage dans l’Aisne
- Luc Mounier, enseignant-chercheur en bien-être animal et responsable de la Chaire
- Claire Rogel-Gaillard, directrice scientifique adjointe Agriculture en charge des systèmes d’élevage durables à l’INRAE
Un débat au-delà de la ferme
Au Sommet de l’Élevage, le 7 octobre dernier, une soixantaine de participants – agriculteurs, chercheurs, représentants du secteur privé, étudiants, retraités et simples curieux – ont répondu présents à une table ronde intitulée : « Reconnecter l’élevage aux citoyens » organisée par la Chaire Bien-être animal. Les échanges ont vite dépassé les frontières de la ferme pour interroger nos rapports collectifs à l’alimentation, au vivant et à la société dans son ensemble. Le questionnement de départ était d’appréhender l’éloignement des citoyens du monde de l’élevage et d’envisager des perspectives pour y remédier.

Des mondes qui se parlent peu
Pour Arnaud Leclercq, agriculteur en polyculture-élevage dans l’Aisne, il s’agit plus d’une incompréhension que d’une déconnexion des citoyens envers l’élevage : « Ce sont deux mondes qui ne parlent pas le même langage quand ils sont éloignés. Quand les gens viennent à la ferme, tout devient plus simple : ils voient, ils comprennent ce que l’on fait au quotidien, et on échange ». Cette proximité directe, il la cultive depuis longtemps : vente directe à la ferme, accueil de scolaires, participation au projet « Dans ta ferme » piloté par Obione… autant d’occasions de retisser des liens entre le champ et la ville.


Ce sont deux mondes qui ne parlent pas le même langage quand ils sont éloignés. Quand les gens viennent à la ferme, tout devient plus simple : ils voient, ils comprennent ce que l’on fait au quotidien, et on échange.
ARNAUD LECLERCQ
Julia Dissard, bénévole à l’association Terre de Liens Auvergne et citoyenne engagée, partage ce constat. Avec Terre de Liens Auvergne, des rencontres sont organisées par les bénévoles entre les citoyens et les éleveurs pour mieux connaître la réalité du terrain. En tant que consommatrice, elle dit avoir pris conscience de sa propre méconnaissance du monde de l’élevage avant d’avoir mis les pieds dans une ferme. Elle rappelle qu’il s’agit là du reflet logique d’une société où 75 % des achats se font en supermarchés et où les citoyens, la plupart citadins, sont souvent déconnectés de l’origine réelle des produits.
Claire Rogel-Gaillard, directrice scientifique adjointe à l’INRAE, invite à regarder cette distance sous un autre angle : « Au départ, les citoyens étaient le plus souvent très contents de partir vivre en ville, c’était un signe de progrès. Avec cela, nous avons oublié que nous partageons tous les mêmes ressources. Pourquoi est-ce important de se reconnecter ? Ce n’est pas de la nostalgie rurale, c’est une nécessité écologique. Comprendre l’élevage, c’est comprendre notre rapport à la rareté et aux ressources, c’est une responsabilité collective. »
Entre attentes sociétales et sentiment d’injustice
À mesure que la société se préoccupe davantage de bien-être animal et d’environnement, les éleveurs se sentent parfois jugés, surtout par des citoyens qu’ils ne côtoient pas souvent. L’agribashing, ce mot souvent décrié, traduit ce malaise.
Pour Philippe Collin, éleveur en Haute-Marne et actif sur les réseaux sociaux pour mieux faire connaître son métier au grand public, « le consommateur m’a délégué la production de son alimentation, mais ne comprend plus mon métier, ne communique plus avec nous. Or j’ai besoin de ce lien avec le citoyen, car il constitue le socle de mon métier, c’est lui qui choisit ce que j’élève ». Philippe plaide pour une pédagogie des réalités agricoles : montrer la complexité du métier, les contraintes, les progrès accomplis, sans chercher à tout édulcorer. « Il faut toujours contextualiser : les images chocs ne disent rien du travail quotidien, ni des transitions engagées sur le terrain ». Pour Arnaud Leclercq, ce lien avec la société est essentiel car c’est ce qui donne du sens à son travail au quotidien.
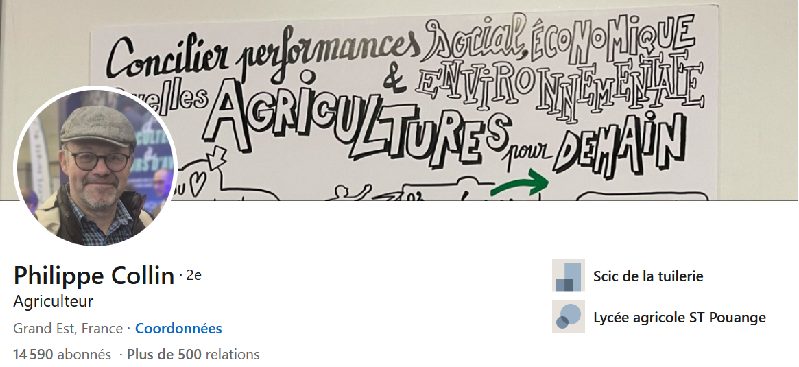
Luc Mounier, enseignant-chercheur à VetAgro Sup et responsable de la Chaire bien-être animal, met le doigt sur un paradoxe bien connu : le citoyen et le consommateur ne sont pas la même personne. Beaucoup réclament un élevage vertueux, mais achètent le moins cher, sans lien avec leurs convictions. « C’est cette contradiction qu’il faut réussir à dépasser ». Et puis, il y a tout ceux qui ne s’intéressent pas au sujet et qu’il est difficile de sensibiliser. Pour Claire Rogel-Gaillard, si tout le monde ne s’intéresse pas nécessairement au sujet, ceux qui le souhaitent doivent avoir les bonnes clés de lecture, car il faut comprendre la réalité pour faire des choix éclairés.
Réapprendre à travers l’éducation et la cuisine
Pour renouer ce dialogue, un levier central fait consensus : l’éducation. Cela commence par l’école, mais aussi par la table. « Si on cuisine, on se soucie du produit, du goût, et donc de son origine et de comment et par qui il a été produit », souligne Luc Mounier. Julia Dissard ajoute : « Il faut certes réapprendre à lire les étiquettes, à visiter les fermes, à rencontrer ceux qui produisent. Cependant, 70 % des produits des fermes françaises sont transformés. Sur les produits transformés, l’affichage de la provenance des produits n’est pas obligatoire. Même un consommateur éclairé ne pourra s’assurer qu’il mange des bolognaises à base de viande française ». Sans compter que le sujet est aussi une question d’avenir à l’échelle de la société, avec d’une part plus de la moitié des agriculteurs qui partiront à la retraite d’ici une dizaine d’années et d’autre part, des jeunes qui ont des visions de l’élevage différentes de celle de leurs aïeux et qui n’ont pas toujours les moyens de manger de la viande.

L’éducation alimentaire, pour Philippe Collin, doit redevenir un pilier de la citoyenneté : « On doit apprendre aux enfants à se nourrir comme on leur apprend à lire ou à compter. On doit réapprendre le vrai goût des aliments, et sortir des goûts standardisés ». Il évoque des grands chefs cuisiniers parisiens à qui il a fait redécouvrir le goût de l’huile de tournesol non désodorisée. La nutrition, la santé et des pratiques respectueuses de l’environnement deviennent alors des portes d’entrée vers une meilleure compréhension de l’élevage et des territoires, qui font partie de notre patrimoine commun.

Sur les produits transformés, l’affichage de la provenance des produits n’est pas obligatoire. Même un consommateur éclairé ne pourra s’assurer qu’il mange des bolognaises à base de viande française.
JULIA DISSARD
Donner la parole à ceux qui font… et aux autres
Mais la reconnexion ne passera pas seulement par les écoles, d’autant que ce n’est pas toujours facile d’amener les scolaires à la ferme, comme le souligne Arnaud Leclercq : il faut trouver les budgets, organiser des journées dans un temps scolaire très contraint, identifier des enseignants motivés, etc. Pour Julia Dissard, ses différentes expériences de woofing lui ont permis de comprendre les contraintes du métier comme les obligations liées à la biosécurité, au poids de l’administratif au quotidien… et une multiplicité de tâches qu’elle ne soupçonnait pas.
Retisser des liens repose aussi sur l’ouverture des fermes, sur les circuits courts, les marchés locaux, les AMAP, et tous ces lieux où l’acte d’achat devient un acte de dialogue. Pour autant, les intervenants rappellent que ces initiatives restent minoritaires vis-à-vis de la grande distribution, qu’il est nécessaire, pour certains, d’associer à ce processus. « Les supermarchés ne sont pas des lieux d’échanges, mais ils façonnent la plupart des comportements alimentaires », constate Julia Dissard. Arnaud Leclercq va plus loin : « Il faut aussi que les industriels et la grande distribution assument leur part de responsabilité. Il y a aujourd’hui une opportunité avec les produits d’origine France qui sont plébiscités par les consommateurs dans la grande distribution ». Une personne du public acquiesce : « Ce n’est pas aux seuls agriculteurs de porter la reconnexion. C’est toute la chaîne alimentaire qui doit retrouver le respect du produit et de ceux qui le produisent. Mettre toujours en avant les prix les plus bas n’est pas respectueux pour le travail des éleveurs. Il faut aussi communiquer positivement autour de l’élevage ».
Les débats soulignent un besoin de travail collectif : éleveurs, chercheurs, consommateurs, élus, politiques industriels… tous doivent être associés à la réflexion. Claire Rogel-Gaillard et Luc Mounier précisent le rôle que peuvent jouer les scientifiques et les chercheurs dans une meilleure compréhension du métier d’agriculteur, dans l’évolution du métier, dans l’apport de solutions possibles, tout en rappelant la nécessité pour les scientifiques de sortir des laboratoires et de se placer dans une approche à la fois de terrain et interdisciplinaire. Un exercice complexe comme le rappelle Claire Rogel-Gaillard : « D’un côté les citoyens doivent comprendre pourquoi et comment le monde agricole a évolué et de l’autre côté, les paysans doivent prendre en compte toute la complexité de la biologie, de l’environnement, avec une transition nécessaire dans une période charnière sur le plan climatique ».

D’un côté les citoyens doivent comprendre pourquoi et comment le monde agricole a évolué et de l’autre côté, les paysans doivent prendre en compte toute la complexité de la biologie, de l’environnement, avec une transition nécessaire dans une période charnière sur le plan climatique.
CLAIRE ROGEL-GAILLARD
Transition : entre urgence et temps long
La question du temps traverse le débat. Peut-on transformer l’élevage assez vite pour répondre aux défis climatiques, tout en assurant notre souveraineté alimentaire ? Pour Arnaud Leclercq, la réponse est claire : « On a besoin de temps pour s’adapter, mais il faut mettre le temps à profit intelligemment. Sur ma ferme, on a déjà réduit de moitié la consommation de gasoil et d’un tiers les engrais. L’agriculture s’inscrit dans des cycles longs, mais la transition est en marche et tous les systèmes d’élevage doivent être aidés, sans jugement, on a besoin de tout le monde ».
Claire Rogel-Gaillard nuance : l’urgence climatique impose d’accélérer, mais aussi de valoriser ce qui fonctionne, d’envoyer des messages d’optimisme. Le plan Éco antibio, par exemple, a permis des avancées concrètes très rapidement. « Il faut que les gens voient les réussites pour que les immobilistes puissent s’y reconnaître », explique-t-elle.
L’élevage, un bien commun
Au fil des échanges, une idée s’impose : l’élevage est un bien commun, indissociable des territoires, des paysages et de notre culture. « On ne peut pas déconnecter l’élevage de l’environnement », rappelle Philippe Collin. Les animaux nourrissent les sols autant qu’ils nourrissent les humains, et leur présence structure la vie rurale. Mais pour que cette évidence retrouve sa place dans les consciences, il faut raconter à nouveau l’histoire du métier, qui évolue et se réinvente, sa diversité et son humanité, sans cacher ses difficultés et ses contraintes : « L’élevage ne va pas bien partout et il faut différencier les différents systèmes d’élevages, les filières qui n’ont pas les mêmes contraintes, il faut être clair là-dessus. Aujourd’hui par exemple, adapter l’élevage des lapins pour renforcer leur bien-être nécessite de trouver des solutions nouvelles car les lapins ont depuis de nombreuses générations été élevés dans des clapiers » précise Claire Rogel-Gaillard. Julia Dissard précise qu’il est aussi important de remettre la question de la mort des animaux, souvent invisibilisée, et le rapport des éleveurs à celle-ci, au cœur du débat sociétal.
La table ronde se clôt sur un message positif. La volonté de dialogue est bien là, et chacun – agriculteurs, chercheurs, citoyens – peut y contribuer à son échelle, et le rôle des politiques publiques ne doit pas être sous-estimé. Comme le résume Arnaud Leclercq : « On ne peut pas toucher tout le monde, mais si on sème un peu partout, quelque part, ça poussera ».
En conclusion
De la salle de classe aux abattoirs de proximité, du marché local aux réseaux sociaux, reconnecter l’élevage aux citoyens apparaît comme une urgence sociétale. Il ne s’agit pas seulement de réhabiliter une profession parfois malmenée, mais de réapprendre à faire société autour des ressources, de la nourriture, du vivant et de retisser un contrat de confiance. L’élevage, en somme, nous parle autant de ce que nous mangeons que de ce que nous sommes et où nous voulons aller.

à retenir
- Le fossé entre citoyens et éleveurs relèverait surtout d'un manque de compréhension que d'une déconnexion des citoyens.
- L’éducation apparaît comme un levier essentiel pour retisser le lien entre citoyens et éleveurs, que ce soit à l’école ou à travers l’alimentation.
- La transition de l’élevage vers des pratiques plus durables demande du temps, mais aussi l'investissement de tous les acteurs : éleveurs, chercheurs, consommateurs, élus, industriels...

Le consommateur m’a délégué la production de son alimentation, mais ne comprend plus mon métier, ne communique plus avec nous. Or j’ai besoin de ce lien avec le citoyen, car il constitue le socle de mon métier, c’est lui qui choisit ce que j’élève.

PHILIPPE COLLIN