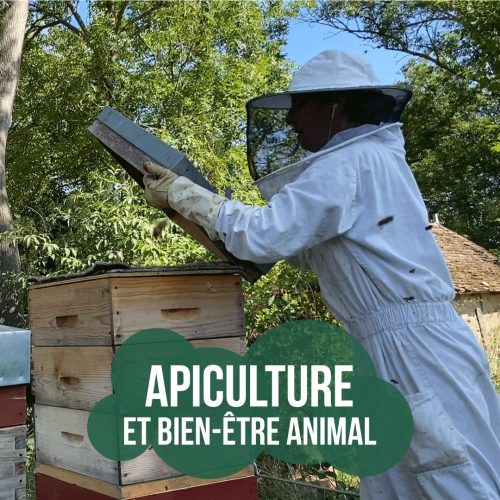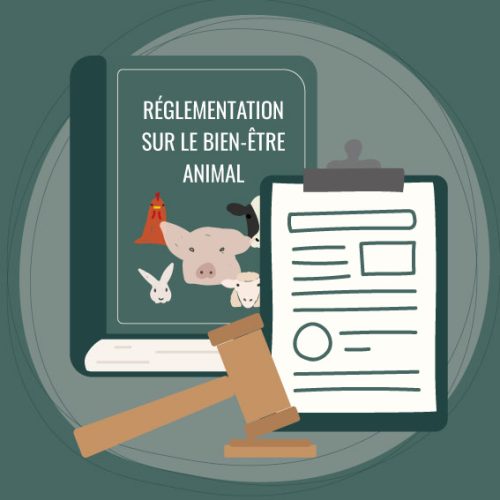à retenir
- Les scientifiques membres du réseau COST Action LIFT ont travaillé à la définition du « positive animal welfare ». Cette définition en anglais n'a pas encore d'équivalent en français
- Le « positive animal welfare » se définit autour de quatre notions : l'épanouissement, des états mentaux positifs, le développement de compétences et la résilience des animaux
- Au-delà de la définition, chercher à prendre en compte les expériences positives des animaux est une avancée importante pour améliorer leur bien-être
Il est maintenant bien connu que les animaux peuvent ressentir des émotions positives. Or pendant longtemps, les recherches sur le bien-être des animaux se sont principalement concentrées sur la limitation des expériences négatives et les indicateurs étaient le plus souvent des indicateurs « d’absence de mal-être » (absence de boiteries, absence de faim, absence de peur…) plutôt que des indicateurs de bien-être.
Ces dernières années, les différents référentiels ont davantage pris en compte les aspects positifs liés au bien-être. Ainsi, le protocole Welfare Quality® utilise le critère « état émotionnel positif » alors que le principe des cinq libertés, plus ancien, utilise le critère « absence de peur et d’anxiété ». Cependant, les connaissances scientifiques sur les expériences de vie des animaux impliquent d’aller encore un peu plus loin dans leur évaluation et leur prise en compte.
Une définition du bien-être animal positif
C’est dans cette optique qu’un réseau scientifique européen, le COST Action LIFT, impliquant 330 scientifiques de 42 pays, a récemment été mis en place. Son objectif est de mieux prendre en compte et d’être capable d’évaluer les expériences positives des animaux d’élevage, en stimulant l’identification, le développement et la validation d’approches et d’outils scientifiques. Une des premières questions a été de définir ce que pouvait être le « positive animal welfare ».
Pour établir cette définition, des scientifiques de différentes disciplines (biologie, éthologie, éthique, sociologie,…) ont été associés. Suite à leurs réflexions, un consensus a été trouvé et un article a été publié fin janvier 2025 dans Biology Letters « A consensus on the definition of positive animal welfare » qui définit le « positive animal welfare » :

Positive animal welfare is defined as the animal flourishing through the experience of predominantly positive mental states and the development of competence and resilience. Positive animal welfare goes beyond ensuring good physical health and the prevention and alleviation of suffering. Positive mental states result from rewarding experiences, including having choices and opportunities to actively pursue goals and achieve desired outcomes, according to species-specific and individual capabilities. Genetic, developmental and experiential factors (e.g. pre-natal, early life, environmental) contribute to individual differences in the ability to achieve positive animal welfare. Positive animal welfare can be assessed using animal-based indicators and can be evaluated over different timescales, thereby contributing to the lifetime picture.
Cette définition peut s’appliquer à l’ensemble des animaux mais elle précise bien que le bien-être est un état individuel, propre à chaque animal, et que la capacité à atteindre un tel état dépend pour chaque animal de facteurs génétiques, de son développement ainsi que des expériences qu’il a vécues. Enfin, l’article indique que cet état de bien-être doit être évalué avec des indicateurs basés sur les animaux et à différentes périodes, permettant ainsi d’avoir une idée de la qualité de vie de l’animal possiblement sur toute la durée de sa vie.
Des précisions sont apportées concernant certains termes utilisés dans cette définition :
- L’épanouissement (flourishing) est ainsi un concept qui inclut sur le long terme des émotions positives telles que la satisfaction ou la joie, ainsi qu’un sentiment d’accomplissement ou de contrôle, et des relations sociales enrichissantes.
- Les états mentaux positifs (positive mental states) incluent à la fois les processus affectifs et les processus cognitifs. Ils résultent d’expériences enrichissantes, y compris le fait de disposer de choix, selon les capacités spécifiques à l’espèce, mais aussi à l’individu.
- Le développement de compétences (development of competence) implique de donner la possibilité à l’animal de faire face à des défis, ou de s’inscrire dans un processus d’apprentissage, afin qu’il développe ses compétences comportementales, cognitives et émotionnelles par exemple.
- La résilience est définie comme la capacité d’un animal à maintenir ou retrouver une bonne santé mentale et physique suite à des perturbations environnementales.
Cette définition précise également que le « positive animal welfare » va au-delà de la bonne santé physique, de la prévention ou encore du soulagement de la souffrance et qu’il s’agit bien d’un état mental positif.
Les implications d’une telle définition
Enfin, l’article indique les implications que peut avoir cette définition. Si cette définition est encore certes conceptuelle, elle permet toutefois de définir un cadre commun pour harmoniser de futures questions de recherche, en intégrant des notions telles que l’épanouissement, les états mentaux positifs, la résilience, l’acquisition de compétences, la poursuite active d’objectifs, la possibilité de faire des choix…
Sur la base de cette définition, l’évaluation du bien-être animal pourrait être enrichie par de nouvelles méthodes, afin d’obtenir une vision globale et inclusive de tous les aspects qui influencent le bien-être de l’animal.
Et en français ?
Pour le moment, la traduction française de « positive animal welfare » et son utilisation sont encore discutées au sein de la communauté scientifique française. En effet, le terme « bien-être animal positif » ne fait pas consensus notamment parce que le bien-être, tel que défini par l’ANSES en France, décrit déjà un état positif de l’animal. Rajouter la notion de « positif » peut alors paraitre redondant en français. Mais nul doute que cet article fait avancer le débat.
Toujours est-il qu’au-delà de la traduction, chercher à mieux prendre en compte les expériences positives des animaux et trouver des indicateurs permettant de mieux les évaluer est une avancée importante pour améliorer le bien-être des animaux.
Ci-dessous une version traduite de la définition originale en anglais proposée par Jean-Loup Rault, le premier auteur de l’article :

Le bien-être animal positif est défini comme l’épanouissement de l’animal par la prédominance d’états mentaux positifs et le développement de ses compétences et de sa résilience. Le bien-être animal positif va au-delà de la garantie d’une bonne santé physique et de la prévention et de l’atténuation de la souffrance. Les états mentaux positifs résultent d’expériences gratifiantes, notamment de choix et d’opportunités de poursuivre activement des objectifs et d’atteindre les résultats souhaités, en fonction des capacités propres à l’espèce et à l’individu. Des facteurs génétiques, développementaux et résultant d’expériences diverses (par exemple, prénataux, dans le jeune âge, ou environnementaux) contribuent aux différences individuelles dans la capacité à atteindre un bien-être animal positif. Le bien-être animal positif peut être évalué à l’aide d’indicateurs collectés sur l’animal et peut être évalué sur différentes échelles de temps, contribuant ainsi à la représentation de la vie de l’animal
Quelques questions à Jean-Loup Rault

professeur et directeur de l’Institut de Sciences en Bien-Être Animal
à l’Université de Médecine Vétérinaire de Vienne (Autriche)
Comment est née cette idée de travailler sur le concept de « positive animal welfare » ?
Depuis la fin de ma thèse de doctorat, en 2011, en écrivant une revue de la littérature sur le support social, je notais dans ma dernière phrase :
« Social support on the other hand might offer the opportunity for the animal to cope successfully with these stressors and increase the experience of eustress (or ‘good’ stress; Selye, 1976), or enhance resilience to stressors (Ozbay et al., 2008), leading to positive welfare and positive experiences by the animal ».
Depuis, je me suis toujours intéressé au fait que, non seulement nous devrions minimiser les causes de souffrance, mais aussi se préoccuper que les animaux soient heureux, aient une bonne vie, ce qui inclut des expériences positives, en plus de l’absence de souffrance. Bien sûr, rien ne se produit dans les sciences en isolation; j’ai probablement aussi été influencé et inspiré par mes superviseurs, comme Alain Boissy et la revue qu’il a dirigé et qui fait office de référence sur le sujet des émotions positives chez les animaux.
Pourquoi avoir choisi d’utiliser une approche pluridisciplinaire pour traiter cette question, et comment ont été déterminées les disciplines ?
Une question aussi complexe ne peut être proprement traitée que par une approche pluridisciplinaire, puisque la question des expériences positives est large, et donc beaucoup de disciplines peuvent offrir des angles et types de connaissances différentes et complémentaires sur le sujet : l’éthologie, mais aussi la neurobiologie, les sciences cognitives, la philosophie et l’éthique, la psychologie expérimentale, et bien d’autres.
Nous avons donc essayé de constituer un groupe de travail aussi pluridisciplinaire que possible, en conservant une taille de groupe permettant des discussions productives.
Quels ont été les principaux débats au sein du groupe de travail au sujet de cette définition ?
Je pense que les débats les plus importants se sont centrés autour de la question si le « positive animal welfare » pourrait être réduit au sujet des émotions positives (certains considèrent les deux termes comme quasiment synonymes), ou alors si c’est un concept plus large qui inclut d’autres expériences ou qualités, comme le développement de compétences et la résilience face à l’adversité (les émotions positives étant plus un moyen ou mécanisme, plutôt qu’une fin en soi, d’un point de vue biologique).
De plus, il y a beaucoup de terminologies différentes dans ce domaine, et donc nous avons beaucoup discutés du choix des mots, des termes à inclure et de ce qu’il contiennent ou émettent comme messages sous-jacents, tout en essayant de rester le plus clair et précis possible.
Comment le travail va-t-il se poursuivre ? Quelles sont les prochaines étapes du réseau COST Action LIFT ?
Cette définition, je l’espère, aidera à canaliser nos efforts dans une direction commune. Il y a énormément de choses qui se passent dans le réseau COST Action LIFT, depuis 2 ans et au moins pour 2 ans de plus, avec plus de 25 groupes de travail, chacun impliquant de 10 à 30 scientifiques ou plus. Je vois ça comme un boost énorme pour avancer sur nos connaissances et approches scientifiques sur ce sujet des expériences positives chez les animaux, en permettant à tous d’échanger et d’apprendre les uns des autres sur un sujet aussi passionnant, mais aussi complexe !
Pour aller plus loin
Merci à Jean-Loup Rault pour la relecture de l’article et pour avoir accepté de répondre à nos questions.
à retenir
- Les scientifiques membres du réseau COST Action LIFT ont travaillé à la définition du « positive animal welfare ». Cette définition en anglais n'a pas encore d'équivalent en français
- Le « positive animal welfare » se définit autour de quatre notions : l'épanouissement, des états mentaux positifs, le développement de compétences et la résilience des animaux
- Au-delà de la définition, chercher à prendre en compte les expériences positives des animaux est une avancée importante pour améliorer leur bien-être
CHIFFRE CLÉ
Nombre de scientifiques membres du réseau COST Action LIFT actuellement